MAGAZINE PROF - PARTAGE
Mise en ligne le 6 mai 2024
Quand l’enseignant fait la différence
L’enseignement explicite expliqué de façon théorique (un peu) et pratique (beaucoup) : voilà ce que proposent quatre chercheurs de l’UMons dans Enseignement explicite : pratiques et stratégies.
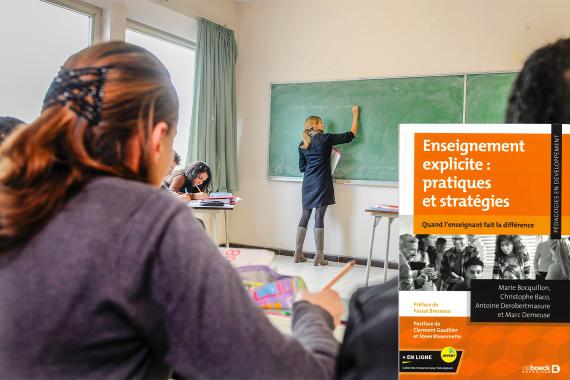
Dès la préface, que signe Pascal Bressoux, la perspective est claire : « les recherches montrent clairement que toutes les pratiques ne se valent pas et que certaines favorisent généralement les acquisitions des élèves ».
Pour les quatre auteurs de l’ouvrage Enseignement explicite : pratiques et stratégies. Quand l’enseignant fait la différence (éditions De Boeck Supérieur), l’efficacité de cette approche pédagogique repose sur des données scientifiques probantes.
Marie Bocquillon, Christope Baco, Antoine Derobertmasure et Marc Demeuse, tous quatre attachés à l’UMons, « ne se présentent pas comme des défenseurs d’une méthode pédagogique en particulier, mais comme des chercheurs qui font état de la littérature scientifique sur le sujet ». Tout en restant très proche du cœur du métier d’enseignant, l’ouvrage fourmille donc de références aux recherches et aux « données probantes » en faveur de l’enseignement explicite.
Un peu de théorie…
Le premier chapitre présente les deux familles d’approches pédagogiques, (socio)constructivistes et instructionnistes, qui, selon les auteurs, se distinguent par le moment auquel l’élève est confronté à une tâche complexe et par celui auquel l’enseignant fournit une démonstration de la manière de réaliser la tâche.
Ensuite, ils insistent sur une méthode d’analyse critique des propositions pédagogiques, soulignant que des innovations reposent parfois sur des opinions et non sur des recherches rigoureuses et empiriques sur leur efficacité.
Le troisième chapitre expose en détail les quatre raisons de mettre en œuvre l’enseignement explicite. Un : tout ne se joue pas en dehors de l’école ou, comme le souligne le sous-titre du bouquin, « l’enseignant fait la différence ». Deux : l’enseignement explicite des contenus favorise l’apprentissage des habiletés simples et complexes auprès de différents types d’élèves de différents niveaux. Trois : l’enseignement explicite des contenus augmente l’engagement des élèves et favorise un climat d’apprentissage. Quatre : il tient compte de la charge cognitive des apprenants.
C’est peut-être sur cette dernière question que les approches (socio)constructivistes et instructionnistes (dont l’enseignement explicite) divergent le plus, mais les auteurs refusent de les opposer de manière stérile, proposant de les placer « sur un continuum de variation du niveau de soutien pédagogique offert ».
… et beaucoup de pratique
De plus en plus pratique, l’ouvrage se penche de façon très fouillée (80 pages) sur chacun des sept gestes professionnels fondamentaux permettant de mettre en place un enseignement explicite : présenter le contenu à apprendre ; donner les consignes ; objectiver la compréhension, le contenu, la métacognition et les représentations des élèves ; donner du feedback ; passer à l’étayage (fournir de l’aide à l’élève afin qu’il réalise une tâche qu’il ne pourrait pas réaliser seul) ; gérer la classe de façon préventive ; et intervenir pour corriger des écarts de comportements.
Un cinquième chapitre lui aussi très concret insiste sur la nécessité de planifier minutieusement les gestes professionnels et étapes à mettre en œuvre lors d’une leçon. Et livre des exemples de planification de leçons basée sur un contenu et sur des comportements.
Un dernier chapitre propose un outil d’observation permettant aux enseignants de porter un regard réflexif sur leurs pratiques, qui sera également utile aux formateurs d’enseignants.
Ajoutons que l’ouvrage donne accès à un cahier de ressources en ligne, et que des articles, outils, vidéos et autres sont centralisés sur www.enseignementexplicite.be.
Et les auteurs de conclure que « si l’enseignant ne peut être tenu responsable des résultats des élèves, il dispose néanmoins d’une certaine liberté, et donc d’un certain pouvoir, pour choisir les moyens pédagogiques à mettre en œuvre dans sa classe, ce qui implique la responsabilité de choisir ceux dont l’efficacité a été démontrée par des recherches empiriques».
D.C.

